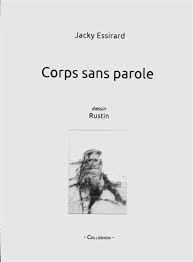est une revue en ligne consacrée au récit de voyage sous toutes ses formes – textes, photos, vidéos, dessins. Sur terre comme sur mer, d’ici ou d’ailleurs, suivez nos artistes-voyageurs sur les chemins du monde!

Réveillé par les oiseaux insolents qui sifflent, jacassent, lancent des trilles dans toutes les langues, je regarde le jardin. La lumière échappe à mes doigts et court sous les arbres ranimer les feuilles.
Ne pas repartir. Vivre là sous les cocotiers, allongé sur une chaise longue. Ne rien faire.
Longtemps.
C’était un rêve. Ce matin, place de la Constitution à Guatemala Ciudad, les touristes se déplacent en bandes comme des pigeons en quête de nourriture. Tout est bon pour cliquer et remplir l’appareil photo : le vendeur de graines dans sa cabane minuscule, les jeunes filles poussant leur chariot de fruits devant les bassins ou les grappes d’enfants qui tournent autour d’un aveugle comme des planètes affolées. Saisis par une courte prise de conscience existentielle, ils dirigent parfois les objectifs vers leur groupe, photographient les passagers de l’autocar au milieu des gamins mal fagotés qui jouent au ballon. Les mondes d’ici et d’ailleurs se côtoient un instant sur une même image.
La visite continue, le guide file sans se retourner.
Dans la cathédrale, mains jointes, une vierge affligée brille d’une douceur dorée, une épée plantée dans le sein gauche. On dit la messe dans une des chapelles. Un christ noir, crucifié entre deux tentures violettes, regarde les fidèles dispersés sur les bancs. Ils murmurent prières et rituels anciens dans leurs habits de tous les jours, courbés sous le poids de Dieu.
Les prières donnent une densité à l’air – sainte Marie, protégez nos âmes. Les saints parés d’or et de bijoux sont à l’abri dans les cages de verre cadenassées.
Maya du soleil et de la ferveur.
Maya des pierres dures.
Jade et obsidienne célèbrent la beauté et la mort. Maya de la langue chantante quiché,de la poussière et des bougainvilliers, des stèles et de l’attente patiente.
Visages fiers que des regards d’encre percent d’un éclair.
Maya de la liberté perdue.
Voilà le Guatemala, fille païenne de l’Église catholique. Je débarque au milieu d’un kaléidoscope, tout de suite pris dans ses couleurs.
Je suis au Guatemala.
Il y a deux jours je bouclais ma valise. Partir. Je ne pensais qu’à fuir mon appartement, ma ville, la France. Echapper à qui, à quoi ? Rien ne me retenait là-bas. J’ignorais si elle aussi avait quitté la ville. Elle n’avait pas évoqué un départ possible. Aucune raison qu’elle déménage, j’étais le vaincu, la victime. Je ne voulais pas la croiser par hasard dans la rue. Alors je n’étais plus sorti de chez moi, laissant mon cerveau fouiller inlassablement le passé. Mille allers-retours de ma chambre à la cuisine n’avaient pu m’indiquer à quel moment notre couple avait vacillé, et pour quel motif. Tout était si simple avec elle, si clair. Je n’avais jamais envisagé une séparation. Entre quatre murs, ivre et dépressif, sans issue en vue à cette tragédie amoureuse, je me transformais progressivement en épave. Un ami m’ayant convaincu que pour améliorer mon état je devais respirer un air différent, j’avais choisi l’exotisme.
J’ignore si cela sera suffisant pour guérir.
Rien de poétique sur la route qui va de Guatemala Ciudad à Puerto Barrios, la plus fréquentée du pays. Camions, autocars, voitures : tout ce qui roule s’y donne rendez-vous. Elle tranche dans le vif de la montagne mise à nu par les éboulements et les travaux. Virage après virage, pris dans le flot de la circulation, nous descendons vers la côte Est entre les collines sèches parsemées de taches claires : des villages étouffés sous la chaleur. La végétation a soif, elle est recouverte d’une pellicule gris sale.
Arrêt rapide dans une station-service. Le café allongé n’a pas de goût, j’en laisse au fond du gobelet en carton. Il est tôt. La salle est bruyante. Touristes et routiers se côtoient, figures blanches, visages d’Indiens, déjà se pose la question de la bonne personne à la bonne place. Dehors, à l’écart, un homme lave consciencieusement son tuk-tuk.
Je me demande ce que je viens chercher aussi loin. Seulement un changement de ligne d’horizon et de nouvelles images ? À moins que je veuille me rassurer et constater qu’éloigné de mes bases, j’existe encore ? Le voyage me paraît déjà absurde. Pourra-t-il combler le vide qui s’est installé en moi ? Quoi qu’il en soit, ce sera provisoire et insuffisant. Le manque tend à se régénérer.
« Salva al pueblo », proclame ce panneau électoral à propos d’un intellectuel à lunettes. Je verrai tout au long du voyage ces immenses affiches sur le bord des routes. « Hagamos una revolución. » Ni mensonges, ni promesses, annonce le candidat. L’élection du président est programmée pour septembre. Les nuages s’amoncellent sur les sommets. L’aigle Sam plane au-dessus des cactus. Chandeliers géants aux bras coiffés d’une touffe blanche. Je rêve de mousse débordant d’un verre de bière.
Le soir je refais le parcours dans ma chambre d’hôtel, constate que je n’ai pas beaucoup parlé, quelques mots au chauffeur, des banalités. Je rassemble dans mon carnet ce que mes yeux ont vu du Nouveau Monde qui déjà se fixe dans ma mémoire. J’écris pour me souvenir mieux, et pour oublier les dernières semaines en France. Le voyage qui m’emporte hors de mes limites se construit en moi. Je sais que je ne pourrai pas tout inscrire : les sons et les parfums resteront ici.
De chaque côté de la route, ce sont pentes pelées, touffes d’herbe presque blanches. Les publicités alternent avec les constructions inachevées. Comme souvent sous les tropiques, des armatures de ferraille dépassent des murs, augurant d’un hypothétique étage. La terrasse sert de toit, ou bien des tôles rouillées font l’affaire. Où qu’on aille, la pauvreté a ses signes de reconnaissance. Elle oscille comme elle peut entre l’espoir d’un avenir meilleur et un présent jamais terminé.
La rivière se démembre en filets d’eau entre les îlots. Des arbres morts gisent sur les gravières. Encore un mois avant la saison des pluies et des tempêtes.
Nous plongeons vers Teculután, dans un remake du Salaire de la peur. Camions remplis de matériaux ou équipés de citernes en tous genres. Notre voiture double en chevauchant la ligne jaune à toute vitesse, laissant sur place une camionnette de cirque et sa musique criarde. Sur le bord de la route des bicoques en bois, couvertes de tôle, proposent une halte, un repos provisoire. Personne ne s’arrête. Ça va trop vite. Les tables restent vides, entourées de courants d’air. Ça sent les pneus cramés. Je serre les fesses sur mon siège, j’ai tenu à voyager devant. J’attends le crash.
J’ai visité les ruines accompagné d’un guide local, un gaillard muni d’un long bâton couronné de deux plumes rouges d’ara. […] Les gradins, murs, moellons, visages de pierres grises, stèles décorées de glyphes, escaliers monumentaux : il y a toujours un abandon, une catastrophe ou un saccage à l’origine des lieux déchus et vacants. Aucun habitant ne croise ma route, aucun fantôme non plus. La nuit, quand les pierres dorment, la nature regagne ce qu’elle a perdu. Les racines soulèvent les fondations, s’incrustent entre les blocs. La végétation étouffe les résistances, habite les espaces. La matière se délite, toits et murs s’effondrent. Tout autour du site, des monticules de terre cachent encore ce qui, un jour, s’était édifié par l’intelligence et l’orgueil des hommes.
Les monuments sont en grande partie dégagés de leur tombe. On a renvoyé la forêt à sa sauvagerie, mais elle est trop proche des allées et des constructions modernes pour faire peur. On restaure, on sauve, on valorise. Satisfaction d’exhumer une histoire. « Imaginez comme nous avons été superbes », disent ces ruines à ciel ouvert. Beauté des restes et voyages dans le temps. Comment retrouver le passé ? J’ai bien essayé de toucher les pierres et de caresser les stèles, pas de transfert temporel, même pas une vision. Peut-être faut-il des champignons et des hierbas naturales.
Dans mon pays intérieur, je possède mes propres ruines. Personne d’autre que moi ne vient les visiter. Je revendique la faute. Je n’entretiens pas la place, pensant que la mémoire suffit à tenir le passé en ordre. Aujourd’hui, des pans entiers de mon histoire se sont écroulés. Oubliés, les lieux et les rencontres. Volontairement ou par négligence. Tout semble friable, sauf les mois passés avec elle que je ne peux effacer. Tenir un journal ? J’aurais dû y penser plus tôt. Je suis une ville qui a connu des années fastes, des moments réputés inoubliables, des désastres aussi. Je suis une ville vieillissante et vulnérable. Je ne m’intéresse plus.
Le village de Copán est gardé par deux chevaux efflanqués qui se nourrissent de poussière. Devant les maisons rouges aux balcons fleuris, de longues tables de breloques attendent au milieu de la rue pavée d’hypothétiques acheteurs. Au café des Singes perdus, les seuls clients sont des hommes.
Avoir le temps, ne pas courir ? Moi, je fais le contraire. Quinze jours pour un tour du Guatemala, pas question de s’attarder. Le vrai voyageur est celui qui ne compte pas, qui peut rester une heure à rêvasser devant un paysage, qui s’égare dans une ville et qui trouve ce qu’il ne cherchait pas.
Guatemala des pierres, des décharges sauvages. Guatemala des ferrailleurs, de la terre sèche qui s’enivre de pluie et se répand en boue dans les villages pauvres. Pays des vaches maigres, des camions aux longs nez, des carrières qui fouillent la mémoire des montagnes.
Guatemala des trafics, de la corruption et des gangs, des vigiles devant les hôtels qui fument cigarette sur cigarette en caressant la crosse des fusils.
Guatemala à la peau fripée, trouée d’îlots de verdure, de volcans et de lacs. Du feu et de l’eau. Guatemala des orchidées. Guatemala de la forêt primaire et des paradoxes.
Miguel Ángel Asturias te salue, Guatemala, ailes blondes et tendres. Je salue tes tombeaux couleur pastel et les têtes de mort décorées, percées d’orbites d’un noir céleste, qui ricanent sur mon passage.
Une halte dans un restaurant au milieu d’un petit parc tropical. […] Balade dans la fausse jungle, mais avec la chaude humidité d’une vraie. Les lianes aussi font semblant. Je reconnais des plantes d’appartement, des philodendrons en liberté, cinq fois plus grands qu’à la maison. Pas de serpent ni de tarentule, mais au creux de la végétation qui borde l’allée, dans la lumière diffuse, des roses de porcelaine aux teintes délicates.
Le pays me pénètre en douceur. Ses tentatives de séduction repoussent dans les coulisses le vrai motif de mon voyage. Je me laisse faire.
J’ai mal dormi. Peut-être la solitude au milieu de tous ces gens qui s’amusent à parcourir un nouveau pays en sautant de site en site, de musée en spectacle folklorique, de restaurant typique en hôtel de luxe. Un cauchemar m’a réveillé bien avant le lever du soleil. Je nageais dans une eau noire qui épaississait et m’empêchait d’avancer. Il y avait un ponton et, accoudée au garde-corps, une forme non identifiable qui me regardait sombrer.
Maintenant, affublé d’un gilet rouge, une bouée autour du cou, je suis des yeux un vol de cormorans qui accompagne le bateau lancé à toute allure vers Livingstone. La coque tape la mesure sur les vagues et coupe l’eau en deux gerbes étincelantes. L’embarcation tangue à peine quand elle croise le sillage d’une autre barque. Sur la côte, les paillotes, les pieds dans l’eau, semblent encore dormir. Une troupe de pélicans perchés sur des structures de béton, ailes déployées ou fouillant du bec leurs plumes blanches, regardent passer notre lancha. Le vent tire, une flamme d’air m’entoure d’une caresse tiède et transforme mes cheveux en une flambée de mèches rebelles.
Dans le canyon, nous naviguons entre les murs d’arbres et de calcaire, le pilote a ralenti le canot pour que je puisse prendre des photos que je ne montrerai sans doute jamais. Les troncs montent verticaux vers le sommet, suspendus dans le vide. Sur un ponton, au milieu de la forêt tropicale, un panneau « Rescue privada ». Deux adolescents se balancent au bout d’une corde et se jettent loin dans le fleuve. Deux boules dotées de membres longs et désarticulés comme des insectes géants qui éclatent la surface de l’eau.
Dans les canaux secondaires, les berges proches laissent le regard pénétrer plus avant mais l’enchevêtrement des racines et des arbres de la mangrove bloque rapidement toute investigation. Je cherche vainement les traces d’un croco. N’importe quel autre animal sauvage serait le bienvenu. Je veux être dépaysé. Le cul d’une bouteille de coca flotte au milieu du rio.
Livingstone, c’est d’abord la musique reggae qui traverse les volets clos d’une maison colorée. Je grimpe en compagnie d’un groupe venu sur un autre bateau. Il s’étire et se défait au fur et à mesure de sa progression, me laissant finalement seul à la traîne. J’arrive dans la rue principale, le village est différent de ceux que j’ai déjà vus. L’ambiance n’est pas indienne. Les visages noirs et les corps élancés rappellent les Antilles. Le métissage transparaît dans la manière de marcher, de se déhancher. Deux enfants en vélo arrêtent en riant une grand-mère édentée qui porte un sac aussi grand qu’elle. Des chants accompagnés de flûte et de guitare viennent de l’église. J’ai perdu la notion des jours. C’est dimanche, la nef est remplie de fidèles.
Un des bouts du monde se trouve ici. Dans ce village qui n’est accessible que par la mer. Les Garifunas n’ont pas la retenue des Mayas. La liberté conquise coule dans leurs veines, irrigue leurs cellules d’un flux indocile et j’ai l’impression d’être entré sur une terre d’aventure. Rien de visible. Les maisons sont coquettes, les rares passants m’ignorent. Pourtant, quand j’achète une bouteille d’eau, des adolescents au regard de pirates discutent dans leur langue en lorgnant mes billets.
Sur la plage, en plein jour, les palmiers ne sont pas à leur avantage. Des petites filles se poursuivent en riant, d’autres se baignent en T-shirt et jupes devant la vierge perchée sur son rocher. J’imagine les fêtes, les pauvres cabanes éclairées d’une guirlande d’ampoules multicolores, le rhum échauffant les têtes, la musique et les coups tordus. Il faudrait rester la nuit, quand les voyous et les aventuriers prennent le pouvoir, quand la ville devient coupe-gorge et porte de l’enfer.
Le cimetière est paisible. Le soleil s’acharne sur la terre et les tombes aux couleurs douces. Les cadavres s’en moquent, rien ne les réchauffera plus. Noirs, métis, Indiens, tous mélangés sous les fausses fleurs des couronnes. Les Rodriguez, Ramirez, Olga Olympia de Blanco (22/04/1920 – 20/04/2001), Pablo Martinez, Carolina Supsall Williams, Fufemio Miguel Ruiz, Enrique Arnoldo Sheppard Ellis, Luisa Zunvrida, os blancs sous la terre entre deux dates. Des vies terminées, dont il reste pour les derniers partis des traces concrètes dans les maisons, dans la mémoire des vivants.
Vie et mort coexistent dans les pays pauvres. La précarité de l’une laisse la porte ouverte à l’autre. En Europe, nous avons perdu ce contact, nous oublions les morts. Nous entretenons une cécité sélective fondée sur le progrès, le présent et la vie facile. Notre désir d’immortalité nie l’évidence. Au contraire, lorsque la vie se réduit à la survie, la mort est une voisine qui s’invite quand elle veut. On a intérêt à avoir des alliés dans l’autre monde, au cas où.
Dans une boutique de change, une jeune métisse me sourit, des années nous séparent. Visage d’icône, dessin parfait. Sa mère plantureuse à côté donne une idée de la suite. Rien à regretter.
Le soir j’écris sur mon carnet l’émotion qui suit ma rencontre avec ce village. C’est peut-être cela, le vrai voyage : la digestion des images et des bruits. Je ne l’ai pas pénétré assez profond, j’ai effleuré son existence et pourtant la plage grise, les enfants dans les vagues, la Vierge sur son roc, le portrait d’une femme opulente assise près d’un chien famélique restent ancrés en moi, amoureusement.
Je vois nettement les peintures naïves inscrites sur les façades des boutiques et la vaine barrière de cocotiers obliques face à l’océan versatile qui lèche avec soin mes pieds. Je parcours les rues déclives, entre les baraques en tôle entourées de jardins luxuriants.
Livingstone, entre sourires et couteaux, dans les lumières éteintes de la fête. Livingstone in love, tu rejoins mon panthéon des villages follement aimés.
Jacky Essirard est né à Angers en 1949. Tout en suivant un parcours professionnel dans une compagnie d’assurances, il a toujours écrit et dessiné. Il a créé deux revues de poésie : Quimper est poésie et plus tard N4728 à Angers. Actuellement président de la Maison Internationale des Ecritures et des Littératures à Angers, il est aussi responsable d’une petite maison d’éditions l’Atelier de Villemorge où il publie des livres d’artistes.
Auteur, poète, dessinateur, peintre et graveur proche des poètes et des écrivains, il a illustré différents recueils et fournit des nouvelles à quelques revues. Pour lui écrire et peindre obéissent au même désir de se sentir vivant et de participer à titre personnel à « l’usage du monde ».